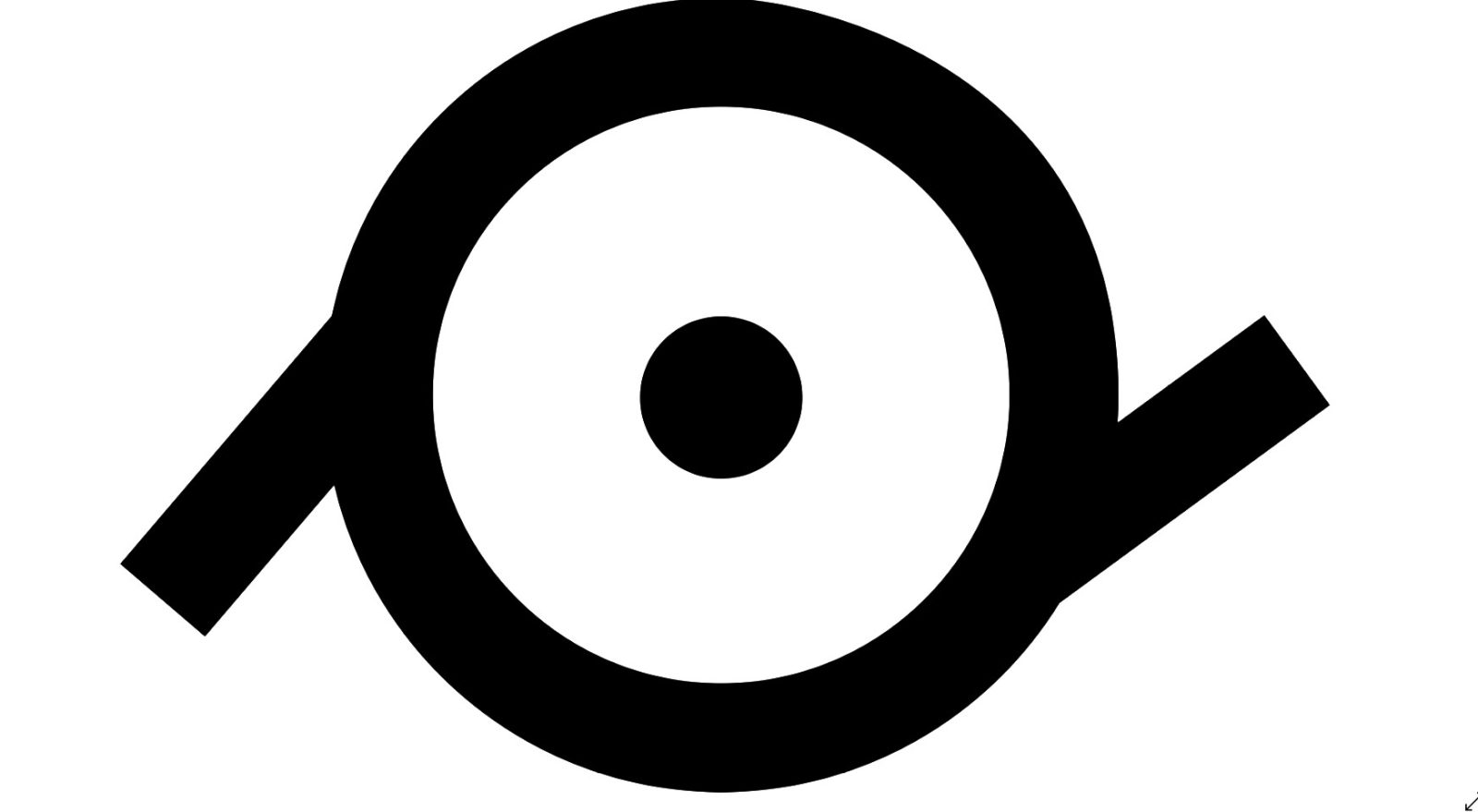La féminisation des titres fait partie de ces «mouvements» linguistiques. Dans la Francophonie, le Québec a été un précurseur dans ce domaine.
C’est en 1977 que l’Office québécois de la langue française (OQLF) a produit un avis en ce sens. On a alors confié la tâche à une jeune terminologue, qui n’était nulle autre que Marie-Éva de Villers, linguiste et lexicographe bien connue, autrice du Multidictionnaire de la langue française.
Elle raconte que la question de la féminisation s’est posée lorsque le Parti québécois est arrivé au pouvoir, en 1976. Plusieurs femmes avaient été élues et nommées au Cabinet, dont une certaine Lise Payette qui voulait se faire appeler «Madame la Ministre».
«L’Assemblée nationale avait demandé un avis officiel à l’Office québécois de la langue française à savoir si c’était possible de le faire, explique Madame de Villers. Il y avait aussi des femmes qui avaient été élues députées et qui voulaient se faire nommer “députées” (et non “députés”)».
L’avis recommandant la féminisation des titres a fait école et la pratique s’est largement répandue depuis dans la société québécoise et dans la francophonie canadienne.
En France, il aura cependant fallu plus de 40 ans pour que l’Académie française emboite le pas et donne finalement, en février 2019, son «imprimatur» à la féminisation des professions.
Pourtant, seulement cinq ans plus tôt, en 2014, cette même Académie déclarait s’opposer vivement à cette féminisation qui, selon elle, «tend à imposer, parfois contre le vœu des intéressées, des formes telles que professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure […] qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation et constituent de véritables barbarismes».
«Le masculin l’emporte»… vraiment?
Féminiser des titres de profession est une chose; rendre toute une langue non sexiste en est une autre. Différents courants et écoles de pensée circulent, mais semblent partager un but commun : se débarrasser de la célèbre règle de grammaire voulant que «le masculin l’emporte sur le féminin».
Tous les linguistes le répètent : cette «règle» voulant entre autres qu’on accorde au masculin un adjectif qualifiant plusieurs noms de genres différents (les souliers et les chaussures sont beaux) est relativement récente.
Pour la linguiste Céline Labrosse, autrice des livres Pour une grammaire non sexiste et Pour une langue française non sexiste, c’est l’ennemi à abattre. «Comment ça se fait qu’aujourd’hui, on enseigne encore cela dans les écoles à l’échelle de la Francophonie? C’est impensable pour moi.»
On impute généralement cette «règle» au grammairien Claude Favre Vaugelas, l’un des premiers membres de l’Académie française qui, dans ses Remarques sur la langue française, publiées en 1647, déclarait que «le masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble».
Au cours de recherches en France, Céline Labrosse a découvert que, 120 ans plus tard, le grammairien Nicolas Beauzée était allé encore plus loin en affirmant que «le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle».
Dégenrer, mais comment?
Pas facile de déconstruire un système linguistique vieux de 400 ans. Et tous les experts ne s’entendent pas sur la façon de «dégenrer» ou d’égaliser les communications.
En 1996, l’OQLF poussait plus loin la féminisation des titres en proposant par exemple «mannequine» comme féminin de mannequin, «substitute», «commise» ou encore «metteuse en scène».
Cette volonté de féminiser les titres d’occupation qui étaient épicènes agace Céline Labrosse. «Ce n’est pas nécessaire de dire factrice et metteuse en scène ; le plus important, c’est qu’il y ait un déterminant – un, une.» La linguiste indique que 29 % de ces titres sont épicènes, comme journaliste, notaire, bibliothécaire, médecin, etc.
Certains vont jusqu’à proposer de féminiser le mot «membre» pour dire «membresse», ou encore de trouver de nouvelles formulations pour que les gens non binaires ne se sentent pas marginalisés, en adoptant par exemple «Mondame» au lieu de Monsieur et Madame.
Pour Marie-Éva de Villers, c’est aller trop loin. «Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ça va être rejeté par la population parce que ce sera illisible. On n’atteindra pas l’objectif recherché. Ça va être un rejet, alors que la féminisation s’est faite harmonieusement.»
Doublets, proximité et neutralité
La rédaction non sexiste, c’est aussi la pratique du «doublet», par laquelle on utilise les formes féminine et masculine (les Canadiennes et les Canadiens). À savoir si l’on place le masculin avant le féminin, cela ne fait pas l’unanimité en raison de la règle de l’accord de proximité.
Celle-ci veut que l’accord d’un adjectif se fasse avec le nom le plus près. Ainsi, si l’on dit : «Les Canadiennes et les Canadiens instruits», le qualificatif «instruits» est au masculin puisqu’il s’accorde avec le nom le plus proche auquel il se rattache, soit «Canadiens». Certains souhaiteraient que l’on applique cette règle si le féminin vient en second, comme dans ce doublet : «Les Canadiens et les Canadiennes instruites».
L’OQLF souligne que «bien que cet accord ne soit pas incorrect grammaticalement», elle ne recommande pas cette façon de faire parce qu’elle peut entrainer la confusion, puisqu’on pourrait comprendre que l’accord féminin ne réfère qu’aux femmes.
Comme le doublet n’est pas une pratique courante et que la forme féminine est souvent omise faute d’espace, on recommande souvent l’écriture neutre. Elle consiste ici à utiliser des formulations qui contournent le problème. Au lieu de «les Canadiens et les Canadiennes», on dirait alors «la population canadienne».
Au lieu de dire «Êtes-vous citoyenne canadienne ou citoyen canadien?», on peut remplacer par «Avez-vous la citoyenneté canadienne?».
Enfin, il y a la pratique déjà répandue du «doublet abrégé», qui consiste à remplacer l’appellation féminine en ajoutant par exemple un «e» au moyen d’un point, d’une parenthèse, d’une barre oblique ou de le placer en majuscule. Au lieu d’écrire «l’enseignant et l’enseignante», on optera pour «l’enseignant. e.», «l’enseignantE», «l’enseignant(e)» ou «l’enseignant-e».
Évidemment, c’est une option qui ne peut se faire qu’à l’écrit.
La rédaction épicène se répand
Depuis les années 1990, des guides ou des politiques sur la rédaction non sexiste ont été adoptés par quelques universités (UQAM, Sherbrooke, Université du Québec à Rimouski) et par les villes de Québec, Lévis, Sherbrooke et Gatineau.
Les démarches de la Ville de Montréal pour se doter d’une telle politique en ont fait sourciller certains récemment. Il a été dévoilé que les instances devant formuler des recommandations quant au futur guide de communications plus inclusives ont fait appel à deux spécialistes de l’Université McGill, Suzanne Zaccour et Michaël Lessard, auteurs du livre Grammaire non sexiste de la langue française.
«Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait appel à ces deux professeurs de McGill qui ne sont pas des linguistes, souligne Marie-Éva de Villers. Tout ça est déjà fait depuis longtemps et publié dans le site de l’Office québécois de langue française.»
Michaël Lessard assure que sa collègue et lui n’ont fait que présenter les grandes lignes de leur livre et que celui-ci «ne propose pas une manière de faire, mais vise à recenser les différents usages.»
Selon lui, la Ville de Montréal va surtout se fier aux directives de l’OQLF.
La langue française étant un éternel débat, celui sur la rédaction épicène risque de se poursuivre encore longtemps.
Michaël Lessard a toutefois bon espoir que plusieurs changements s’imposeront. «Ce qui est certain, à tout le moins, c’est qu’on n’ira plus à la règle de base voulant que “le masculin l’emporte sur le féminin”. Je crois que le mouvement est trop fort pour qu’on imagine que ça retourne vers cette règle-là. C’est vraiment dans les prochaines années qu’on pourra voir comment l’usage va se stabiliser sur les stratégies d’emploi du féminin.»